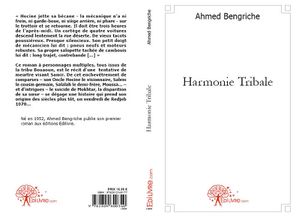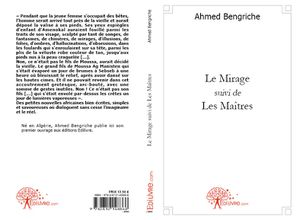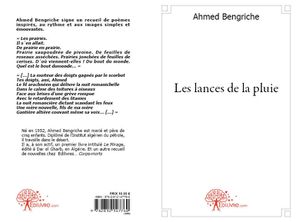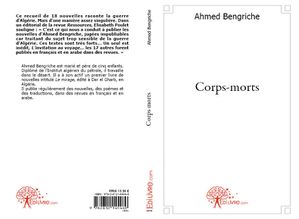Reprise d'un cantique profane sur le thème de l'exil et de l'étranger
Non pas en exil.
Non pas étranger.
Solidaire des hommes et des bêtes
Solidaire des eaux, de la boue,
de la roche et des champs des forêts et forêts de constellations.
Graine de la grande tribu des sables et cailloux
de toute cellule vivante,
pétales de floraison dans le vent,
solidaire de la joie et de la douleur.
D’une patrie de pensée infinie
de toute connaissance limitée
clairières de notre pensée finie.
Solidaire d’une commune ignorance
de tous nos forages, explorations, recherches
de notre désir infini de comprendre —
de toute lumière et de promesse de lumière
qu’elle témoigne d’elle-même ou de la nuit,
de celle à certaines heures que respirent
au désert de Judée les pierres —
Solidaire d’une patrie de mouvement infini
des limites de nos ici et maintenant innombrables
Non, je ne suis pas en exil,
chez moi dans le jaillissement
dans la chute et dans l’usure
dans le diamant et la pacotille
chez moi dans la jubilation des eaux et des airs
et comment parler du mouvement sans bornes
sous les averses d’averses de photons
les vitesses de tant de rayonnements
dans la fraîcheur fragile du verger en fleur
rencontré ce matin de février sans nombre
dans l’éventail d’années et d’années de lumière —
je suis le marcheur qui respire l’ouvert
de tous ses poumons et dont le corps-cerveau
compose des images, musiques et langues,
je suis celui qui chante dans le chant
hors métrique et hors vocabulaire
les matins de toute vie et les soirs
et les nuits de solitude peuplées
de pensées qui s’envolent de leurs fenêtres
de tout ce qui se déplie, telles les eaux
que parcourt un battement d’aile dans la nuit
de l’eau solidaire de celui qui dort,
comme de celui qui écoute le poème au-dedans, au-dehors
*
J'ai seulement des choses très simples
le soleil s'est découpé peu à peu comme
ma mère découpait le pain
nous mettons la soupe sur la table
(ces choses au-dehors qui tombent lentement,
le jasmin, la neige, l'enfance)
goût de piments rouges et de dents heureuses
nos corps nous tiennent encore chaud quelque temps
dans l'âge avancé de la nuit.
Le quatrième état de la matière, Flammarion
*
Bonjour à toi qui viens de nuit.
Bonjour à toi démarche souveraine qui fends la pulpe du
soleil.
Bonjour à toi dans la poussière.
Tout ce jour à t'user, à l'user.
Aux os de ta fatigue.
Lorsque la lumière se voûte sur un puits -
Paix, les bruits se posent.
Ah, comme l'oreille se lisse!
Bonne nuit à toi qui viens de lumière, qui viens silence.
Comme une ultime paupière de couleur ou de son
Tu migres en profondeur, laissant le jour blafard sur la
table de l'embaumeur.
Sol absolu Gallimard
*
Langue natale
Les contraires qui sont battement au cœur du monde, la
parole les porte à déchirure.
Dans la dislocation que plus rien ne guérit, la ferveur d'une
langue dévore son avenir.
Fouet d'une phrase sans équivoque.
Ici s'est tenue la lumière d'un arbre, là s'est dissoute la venue
d'un pas.
Dans le buisson des cris le dieu se creuse de mutisme.
Quelque flamme que tu portes - si peu cette eau qui s'évapore.
Fraîche amertume du sel dans les plis de lumière.
Approche de la parole, Gallimard
*
le blé des corps dans la meule des ans
farines que mélangent les lois éternelles
pour d'autres pains et d'autres dents
la nuit tu tâtes soudain sans comprendre
la peur qui fouille au ventre des images
cherchant à clore sur soi le mouvement
et ces eaux nues de l'ardeur d'aller
encore et encore plus loin dans l'ouvert?
(et même et surtout quand la nuit se referme)
Patmos et autres poèmes, Gallimard
VOICI DES MAINS
Voici des mains
Pose-les dans une brève secousse de ton corps
avec un pot de basilic
et l’espace fouillé des oiseaux,
quand l’aube sur nos corps mouillés
les doigts sentent encore l’origan.
Dans ma bouche les mots crèvent de froid
Dans les grandes chambres inhabitées de ma voix
Le blond friable des collines
Personne ne sait
Le destin des couleurs en l’absence des yeux.
Tout s’arrête
décembre désert
les bras lourds.
La lumière se cherche sur nos mains
Et soudain tout est plume
On s’envole comme une neige à l’envers.
Je tiens ma vie comme
Un morceau de pain
Très fort
Les cent grammes du prisonnier de guerre
Et souvent j’ai si faim
Qu’à peine il en reste
Et les choses se colorent
De peurs merveilleuses.
Dans les yeux d'une femme bédouine qui regarde
L'objectif d'un appareil pas visible sur la photo,
Non plus que la concrétion de temps et de technique ainsi marchandée
À beaucoup de sa vie difficile et fragile,
Dans son regard entre une toile de tente et nulle part,
On voit très bien le mouvement des yeux couleur de lointain
De l'écrivain qui n'a pas su résister
Au désir de photographier. Est-ce qu'on va comprendre vraiment
Ce que cette femme a donné à l'amitié rusée
De son geste ; même si elle n'a pas su
Que l'appareil la regardait ? Tout un léger théâtre de presque rien; et maintenant cette autre énigme: ce qui est échangé
À travers ce qui est montré.
James Sacré/Lorand Gaspar (photographies de), Mouvementé de mots et de couleurs, Le temps qu'il fait, 2003, page 16.------------------------------------------------------------------------------------------
DEPUIS TANT D’ANNÉES…
Depuis tant d'années je lave mon regard
dans une fenêtre où ciel et mer
depuis toujours sont sans s'interrompre
où leurs vies sont un, sont innombrables
sont une fois encore dans mon âme
un champ magnétique d'épousailles
une goutte de lumière-oiseau.
Depuis tant d'années je lave mon regard
à la première couleur si fraîche
sur les lèvres humides de nuit
d'être la peau et d'être la pierre
où mes doigts rencontrent le secret,
ce savoir qu'ils sont et celui qui est
des tonnes infinies de lumière.
Du plus pâle au tranchant du plus sombre
sans s'interrompre entre sang et pensée
entre feuille pinceau étendue
corps de liquide musique à jamais
Lorand Gaspar, Cahier Lorand Gaspar, Cahier Seize, éditions Le Temps qu’il fait, avril 2004, page 71.
Écailles
Mort où tant de vie s’égare
de nos faibles yeux abandonnée.
Torrent tu nous étonnes
étincelant et boueux
de bouche en bouche
le doux et l’amer
cailloux et bois
achevés repris.
Ces photos floues
que le temps a bougées.
La lumière se cherche sur nos mains
et soudain tout est plume
neige neige —
Le même vent traîné dans le feu
la même nuit avec la même texture de branches
d’un bonheur inavoué.
La même croissance dans les gestes
et l’effeuillement des mains sur la peau
trouées soudaines dans les formes
quand l’espace nous entend —
Nous avons vécu tout juste
le temps de ce poids
de tout ce qui sans plainte se déchire
ta vue hier soir
et ces tout petits ports des yeux
les paupières repeintes.
[…]
Lorand Gaspar, Sol absolu et autres textes, Poésie / Gallimard, 1982, p. 67-69.
Il regardait la tourmente saisir
à bras-le-corps et jusqu'au fond des eaux
murmurant quelque chose sur le vent
qui vendange le raisin de la mer -
ces puits d'air et d'espace où plonge
ailes repliées l'ange sans merci
éclair de beauté qui perce la nage
et dévore la pulpe de l'éclat,
la chair vive d'un mouvement de Dieu -
l'esprit du vent tendu entre les lames
dans chaque battement du corps à corps
sur les touches de l'immense clavier
martèlement au coeur de la pensée -
le beau est-il séparable du vrai ?
fruits, saveurs, et si claires dissonances
lavez, lavez encore nos images
.
LORAND GASPAR
Monastère
Peut-être une faille qu'ouvrait
Dans le flanc rocheux le silence
souffle qui fut là de toujours
poumon clair d'esprit dans la pierre
levant le pain très blanc d'un cri
dans le corps sombre des basaltes –
fenêtre éclose dans nos mots
l'esprit indivis parlant à l'esprit
un troupeau paisible de chèvres
broute l'odeur du vent salé
falaise et mer, corps et visages
plis et creux d'un même rayonnement
le mutisme soudain des eaux
dépliant d'un coup l'inimaginable –
Lorand Gaspar
il y a si longtemps que j'essaie
de toucher la nuit les fronces légères
que fait l'eau dans le silence —
toucher dans le corps frileux, froissé
le souffle de Dieu sur les eaux
cette chose qui éclaire mes images
et parfois de si loin les déchire
les yeux de nuit un instant grand ouverts
regardent chaque son ou battement brûler
d'un insoutenable qu'il faut soutenir —
Lorand Gaspar .Extrait « Patmos et autres poèmes », Paris : Gallimard, 2001
POÈMES D’ÉTÉ À SIDI-BOU-SAÏD
à Roger et Patricia Little
Ecriture ample, d’un seul trait qui démontre sa source
et son élan – martinets –
se dépliant par d’immenses caresses, épousant les pleins,
les creux et les failles du corps invisible des vents.
Tant de tiges qui s’élancent, se plient et se déplient, se
cassent sans se rompre, d’un même mouvoir en lui-même enraciné,
mouvoir, telle une pensée lisible un instant sans mot et
sans trace
coulé dans la pleine jouissance de son être indivis
tout un ciel d’afflux de sèves, de rumeurs d’éclosion
ô certitude d’être ici sans reste exprimé dans son faire !
Plongées et rejaillissement souples, toujours légers,
infiniment légers,
torsades et dislocations tracées avec la même assurance
fluide,
comme si le mouvement de la vie, sa trajectoire
incalculable se dépliaient
dans la substance même d’une infrangible unité –
Le gracieux don de bâtir ces hautes voûtes éphémères
où résonne
mêlé aux brefs appels pointus le bonheur du regard
d’habiter
ces traits qui volent et dessinent leurs arcs innombrables
lumière sur lumière –
C’est la seule écriture que tu puisses lire aujourd’hui.
Comme si ta rétine et les neurones gris où s’élaborent
et se dissolvent ces dessins purs d’un seul élan tracés
(dans le bruissement discret de courants et de chimies)
comme si les pins fins rameaux de ton souffle et de ton
sang
tout ce que ton esprit croit comprendre et ignore,
les espaces et une pensée infiniment ouverts
étaient fondus dans le même déploiement
en cette musique où chaque note est un cœur
au rythme, harmoniques et timbre singuliers –
Sois tolérant pour tes failles et faiblesses,
accueille le silence dans les mots qui s’accroît
tout comme le dépouillement des vieux jours
rappelle-toi ce que tu as perçu d’invisible au désert –
la brise du petit matin cueille en passant
l’odeur des genêts et soulève le rideau
Poème extrait de Patmos, Gallimard, 2001
Lumière de loin
Je voudrais t’insuffler la fraîcheur
Capillaire par capillaire
Que t’enfante le glissement de l’air
Et le resserrement des papilles
Te faire des mots verts
Au matin des mots
Que tu ais envie de toucher
De broyer
T’écrire avec les ongles
Dans l’age paresseux des roches
Dans les yeux
Te convaincre de la terre
Lorand Gaspar .Sol absolu
LANGUE NATALE
Les contraires qui sont battement au cœur du monde, la
parole les porte à déchirure.
Dans la dislocation que plus rien ne guérit, la ferveur d'une
langue dévore son avenir.
Fouet d'une phrase sans équivoque.
Ici s'est tenue la lumière d'un arbre, là s'est dissoute la venue
d'un pas.
Dans le buisson des cris le dieu se creuse de mutisme.
Quelque flamme que tu portes - si peu cette eau qui s'évapore.
Fraîche amertume du sel dans les plis de lumière.
Approche de la parole, Gallimard
VOICI DES MAINS
Voici des mains
Pose-les dans une brève secousse de ton corps
avec un pot de basilic
et l’espace fouillé des oiseaux,
quand l’aube sur nos corps mouillés
les doigts sentent encore l’origan.
Dans ma bouche les mots crèvent de froid
Dans les grandes chambres inhabitées de ma voix
Le blond friable des collines
Personne ne sait
Le destin des couleurs en l’absence des yeux.
Tout s’arrête
décembre désert
les bras lourds.
La lumière se cherche sur nos mains
Et soudain tout est plume
On s’envole comme une neige à l’envers.
Je tiens ma vie comme
Un morceau de pain
Très fort
Les cent grammes du prisonnier de guerre
Et souvent j’ai si faim
Qu’à peine il en reste
Et les choses se colorent
De peurs merveilleuses.
Lorand Gaspar
"La gorge peut délivrer le silence, le chant, la parole ou le cri d’angoisse quand elle se
resserre sur son souffle le plus désespéré ; “ce rien qui coule” est entre vie et néant ;
la “houle emporte” pour perdre comme pour sauver… La “ligne de partage” est parfois à
peine discernable entre la tempête qui ravage au-dehors et le “bonheur d’entendre le
vent au-dedans —” ( ). “Tant de choses incomprises”, et qui le restent selon l’art trop
ordinaire du comprendre, n’interdisent pourtant pas l’effort d’un “com-prendre” — attentif,
presque muet, poétique en un mot — où, en soutenant l’insoutenable, “l’être ici”
(parfois “cinglant”, parfois plein d’“ardeur”, magnifique parfois) s’harmonise un instant
avec “la force tranquille d’être là des choses” dans “l’indessinable/ pure jouissance
d’être” un instant seulement…
Lorand Gaspar
Un soir devant la cheminée à Saint Rémy du Val
Craquement épars
Décousus hérissés du bois
De loin en loin le tracé
Rouge d’un tir les éclats
D’une langue oubliée ou qui sait
A l’état de tessons, bris de
Bonds, de rumeurs et de vents
Stellaires ou le simple
Froissement de nos silences
Prennent-ils le feu aussi à un moment
Ces flammes sont-elles comme une danse
Qui cherche ses racines dans la nuit
Vécues, senties au long d’un vie
Dehors la nuit est blanche,
Dans l’âtre, ardent et fragiles
Battements de braise de nos vies-
Des flocons de neige bougent
Dans les blancs de nos livres
Peut-être dans les mots
De temps à l’autre que l’on dit –
Lorand Gaspar
Soleil essoufflé
Toi soleil coureur essoufflé
couché bouche à bouche sur les eaux
sur la mer ouverte à tous vents
la barque de nos mains dérive
or fumé, brûlé des visages
dans la pénombre des années
gardant au-dedans ses lueurs -
musique
nos doigts raclent
des cordes invisibles
dans la lumière dissoute
chaude étoffe arrachée
à l'hiver -
Lorand Gaspar .Patmos et autres poèmes (Gallimard, 2001)
Lorand Gaspar